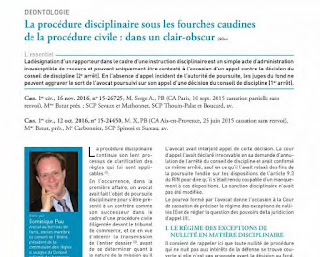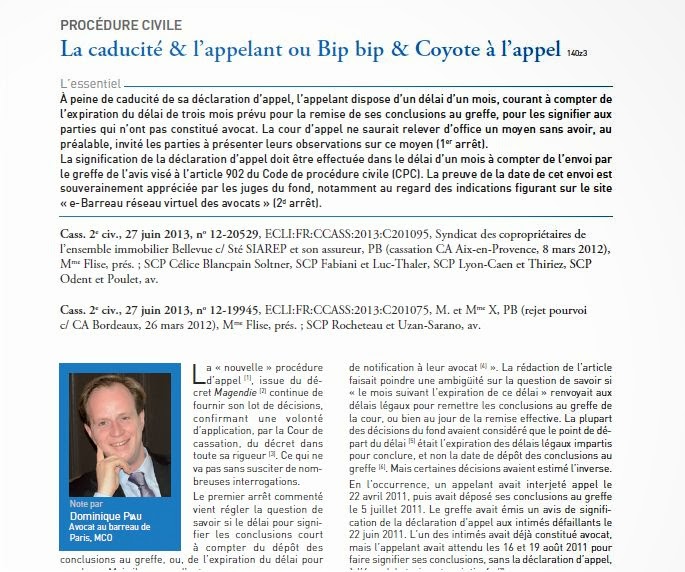Par son arrêt du 19 décembre 2024 (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question inédite en matière de fixation des honoraires : celle du délai pour solliciter, auprès du président du tribunal judicaire, l’exécutoire de la décision de fixation rendue par le bâtonnier.
L’arrêt permet au passage de découvrir toutes les étapes que peut connaître une demande d’exécutoire d’une décision du bâtonnier en matière de fixation des honoraires (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.360 et s.).
Au cas d’espèce, la décision de fixation rendue par le bâtonnier, pour un montant de 500 000 euros HT …, datait du 1er août 2002, et le recours à son encontre avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du premier président en date du 3 décembre 2003, mais l’avocat avait attendu 2017, soit 15 ans … !, pour saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il appose la formule exécutoire sur la décision de fixation.
Le président du tribunal judiciaire avait, par une ordonnance en date du 19 décembre 2017, rejeté la demande, et, sur appel de l’avocat, la cour d’appel avait, par un arrêt non contradictoire du 5 avril 2022, infirmé l'ordonnance et rendu exécutoire la décision de fixation. Les débiteurs avaient alors demandé la rétractation de cet arrêt, mais la cour d’appel avait, par un second arrêt en date du 6 décembre 2022, rejeté leur requête en rétractation. C’est de ce dernier arrêt dont la Cour de cassation était saisie.
La cour d’appel avait considéré qu’il n’y avait pas de délai de prescription applicable, faute pour les textes d’en avoir prévue un.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que : « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), évacuant, de ce seul chef, toute idée d’absence de prescription, procède en deux temps à la recherche de la prescription perdue.
Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette l’application du délai de dix ans, attaché aux titres exécutoires, faute pour ladite décision de fixation de constituer une décision juridictionnelle (ce qui a toujours été sa position : v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.281 et s.).
Pour la Cour de cassation :
« (…) la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, fit-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).
Dans un second temps, elle en conclut que :
« (…) la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).
La demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit ainsi être présentée dans un délai, suivant les cas, de deux ans (en présence d'un consommateur si l'avocat est le demandeur), quatre ans (Etat et collectivités) ou cinq ans.
Cette solution est déjà celle qui prévaut en matière d’exequatur des sentences arbitrales.
Reste en suspens la question du point de départ de ce délai, lequel n'était pas en débat puisque la cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas de prescription applicable.
Logiquement, dès lors que le délai initial aura été valablement interrompu par la saisine du bâtonnier (v. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n°14-25.892, P), le point de départ du (nouveau) délai devrait être non pas la date de la décision de fixation, ni celle de sa notification, mais plus certainement la date à laquelle la décision de fixation devient définitive (expiration du délai d'appel en principe, ou la notification l’ordonnance d’irrecevabilité du premier président, comme au cas d’espèce) dès lors que l'on ne peut pas solliciter l'exécutoire avant cette même date ...
... sauf en cas d'exécution provisoire de la décision de fixation (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.381 et s.) où ce même point de départ devrait alors être … la date de la notification de la décision de fixation.
Et, ce même délai devrait être interrompu par le dépôt de la demande d’exécutoire auprès du président du tribunal judicaire.
Quoiqu’il soit, il ne faut jamais tarder pour solliciter ledit exécutoire. Quitte à temporiser ensuite dans le cadre de l’exécution.